Etape 38 - Musée Groeningen - La belle époque de Bruges et Anvers
Mardi 5 février 2019. Je poursuis ma visite des premières salles du Groeningen Museum*** et j'avance dans le temps avec la belle époque du XVIe siècle, à Bruges et Anvers, époque bénie pour la riche bourgeoisie, et pour les nobles, qui aimaient tant poser pour les grands maîtres de leur temps. Affublés de leurs plus beaux atours, dans des décors familiers, urbains ou privés, tout était prétexte à se mettre en scène tout en étalant sa richesse ou son pouvoir. Et souvent, les deux.
|
Impossible de commencer cet inventaire sans citer l'un des plus talentueux, spécialiste du genre, en la personne de Frans Pourbus I (1545-1581), qui réalisa vers 1570, ce Portrait de Théodore de Bèze. Professeur de grec, peint avec ses livres, avait la particularité d'être né... dans la belle cité de Vézelay. Vêtu d'un manteau noir avec un chapeau noir, le successeur de Calvin pose dans la stature rigide des adeptes de la nouvelle foi chrétienne.
|
Exposés côte à côte, les Portraits des archiducs Albert et Isabelle sont également peints par Frans Pourbus. Frans Pourbus (ou Porbus) dit le Jeune, né à Anvers vers 1569-1570 , mort à Paris en 1622, est un peintre flamand, sujet de la couronne d'Espagne, fils de Frans Pourbus l'ancien. Frans Pourbus commence par se distinguer comme portraitiste à la cour de Bruxelles où il peint l'archiduc Albert et son épouse l'infante Isabelle. Ses deux tableaux les plus représentatifs de cette époque sont justement ces deux toiles exposées au musée de Bruges. |
|
|
Remarqué par le prince de Mantoue, Pourbus fait rapidement ses valises en Italie où il coitoiera un autre peintre flamand majeur, Pierre Paul Rubens. Puis il suit la soeur de la duchesse de Mantoue jusqu'à la cour des Rois de France, à Paris, dans le sillage de Marie de Médécis. En 1618, il devient officiellement "peintre du roi". Parmi ses autres œuvres marquantes, le Portrait de Henri IV (cuirassé), le Grand Portrait en pied de la reine Marie de Médicis portant la somptueuse robe aux fleurs de lys de son sacre, un autre portrait de Marie de Médicis en habits noirs de deuil. |
Parmi les chef-d'oeuvre exposés dans cette salle, il convient d'admirer La prédication de saint Jean-Baptiste, de Pieter Bruegel le Jeune (1564 - 1638). Cette oeuvre, comme bon nombre de l'atelier que l'artiste dirigeait, était une copie de l'oeuvre originale de son père. Il existe pas moins de 25 copies de cette oeuvre ! Mais quelles copies ! La production importante de son atelier, destiné au marché local et à l’exportation, a contribué à la diffusion internationale des images de son père.

Pieter Brueghel le Jeune a ainsi copié les célèbres compositions de son père par le biais d'une technique appelée ponçage. Cette activité à grande échelle n'a été possible que grâce à son grand atelier bien organisé. La comparaison de certaines copies avec les originaux révèle des différences, à la fois en termes de couleur et d'omission ou d'ajout de certains détails. Cela peut indiquer que le copiste a remanié certaines sections, ou peut-être que les copies sont basées sur des impressions postérieures aux œuvres originales, plutôt que sur les originaux eux-mêmes. Dans l'oeuvre exposée à Bruges, il a ainsi omis l'homme barbu en noir, tournée vers le spectateur qui est présent dans l'original.

L'oeuvre orignale peinte par Bruegel l'Ancien se trouve aujourd'hui au musée de Budapest. Les prédicateurs protestants parcouraient les Pays Bas pour prêcher dans la nature. Bruegel représente St Jean Baptiste désignant le Christ en robe claire, de sa main gauche. On pense que le peintre s'est peint de profil et barbu en haut et à droite du bord extrème du tableau.

Hélas, impossible de retrouver le nom et l'auteur de cette oeuvre. Si quelqu'un la connaît, n'hésitez pas à me contacter sur mon mail : jeanlouismace4@hotmail.com




Hélas, impossible de retrouver le nom et l'auteur de cette oeuvre. Si quelqu'un la connaît, n'hésitez pas à me contacter sur mon mail : jeanlouismace4@hotmail.com


Incontournable encore, le Triptyque de Job***, datant du début du XVIe siècle attribué à l'atelier de Jérôme Bosch. Le triptyque dispose encore de son cadre d'origine, dont les contours en « épines de chardon » s'apparentent à ceux d'autres polyptyques réalisés, pour la plupart, après 1515. Ouvert, il présente trois panneaux partageant le thème chrétien de la persévérance dans la foi malgré les souffrances qui mettent celle-ci à l'épreuve.

Le grand panneau central illustre Les Épreuves de Job, conformément au Livre de Job et aux traditions médiévales du Nord de l'Europe. En arrière-plan, au delà d'une rivière bordée d'une haie d'arbres, une ferme opulente est ravagée par un incendie. Il s'agit de celle de Job, détruite par Satan avec l'autorisation de Dieu afin de mettre à l'épreuve la foi de cet homme connu pour sa piété. Job, qui a ainsi tout perdu, est assis sur la paille d'une sorte de mangeoire, dans les ruines d'un grand bâtiment. Presque nu, il ne porte qu'une cape rouge et une sorte de périzonium blanc qui évoquent l'iconographie de la Passion du Christ, épisode du Nouveau Testament annoncé par les épreuves infligées à Job selon le principe de la typologie biblique.

L'expression de Job est calme, ce qui démontre sa résignation et sa confiance en Dieu. Son corps est portant couvert de taches évoquant une sorte de lèpre : cet « ulcère malin » est une nouvelle épreuve infligée par Satan. Ce dernier surgit d'une brèche dans la muraille, sur la droite, suivi par d'autres personnages : s'agit-il d'une allusion aux trois amis venus voir le malheureux ? Satan, dont le caractère diabolique est signalé par son pied griffu et par sa tête de renard, tient dans sa main gauche un faisceau de verges destiné à tourmenter davantage Job. De sa main droite, il esquisse un geste d'invitation (à subir son sort avec patience ou, au contraire, à céder en maudissant Dieu ?) à l'attention du pauvre homme, qui est retourné vers lui mais sans vraiment le regarder.

Au premier plan, à gauche, six musiciens jouent d'étranges instruments. Il y a notamment une sorte de violoneux faisant glisser son archet sur le crâne d'un cheval. La présence de cette étrange compagnie pourrait dériver des paroles de Job à propos des « méchants » qui négligent Dieu, « chantent au son du tambourin et de la harpe [et] se réjouissent au son du chalumeau ».

Le volet gauche représente La Tentation de saint Antoine. Abrité sous une sorte de feuille d'arbre disproportionnée, le saint est représenté à genoux, les mains jointes, priant face à une croix très simple posée sur un petit autel. Il ne prête attention ni aux petits démons, zoomorphes ou anthropomorphes, qui s'agitent autour de lui, ni à la séduisante figure féminine apparue derrière lui. Celle-ci était plus présente dans le dessin sous-jacent avant d'être partiellement dissimulée lors de l'achèvement du tableau. Au loin, on voit une ville où une église est en proie aux flammes et aux attaques de démons volants. |
|
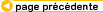

|

